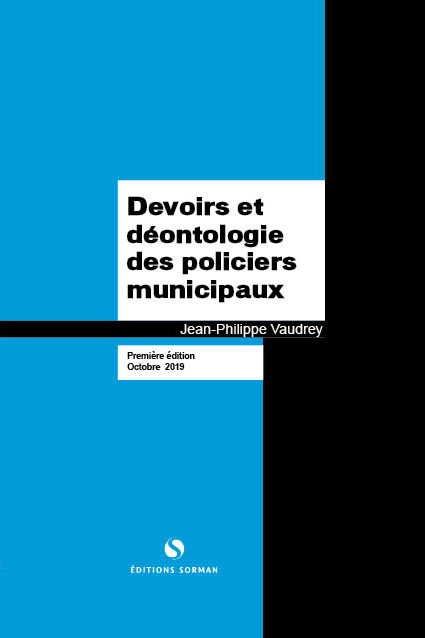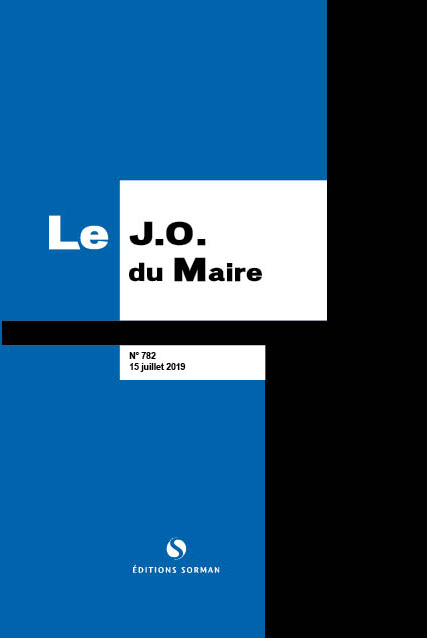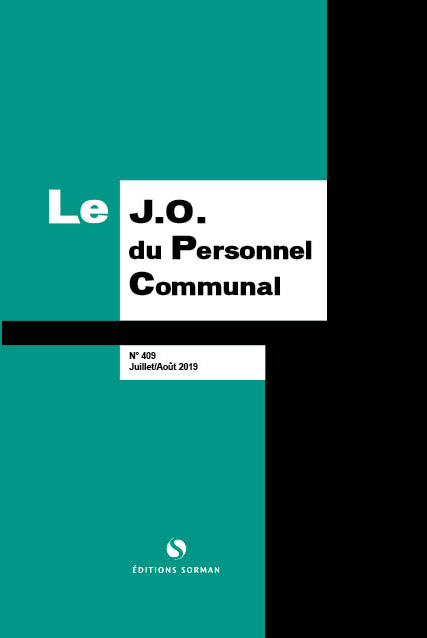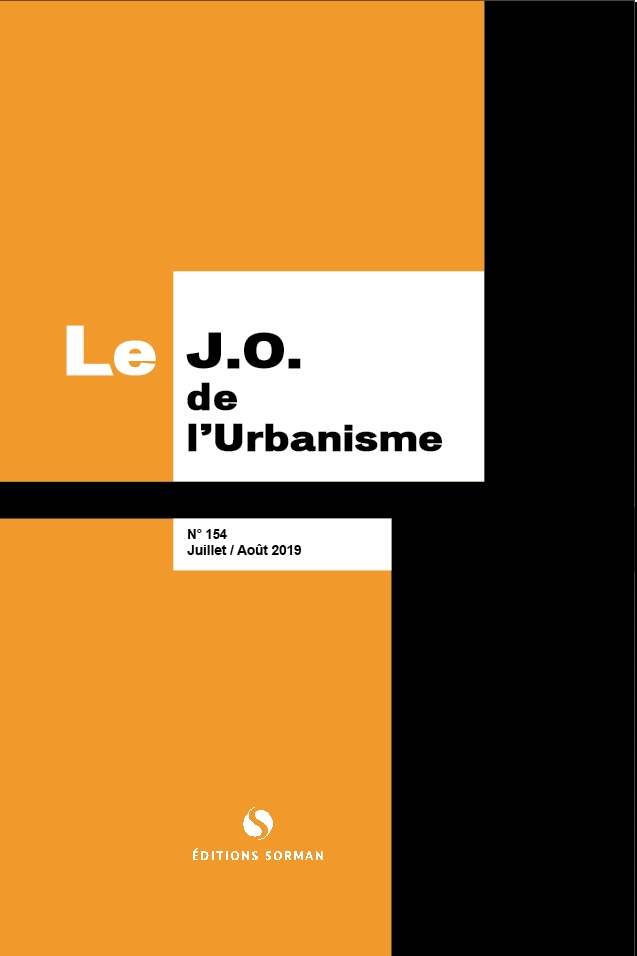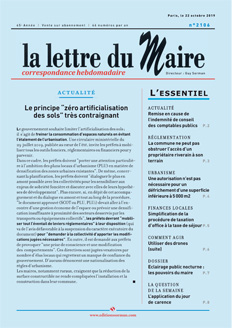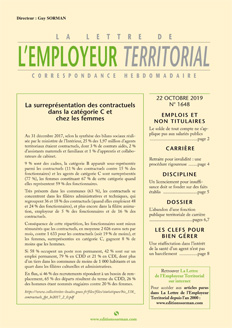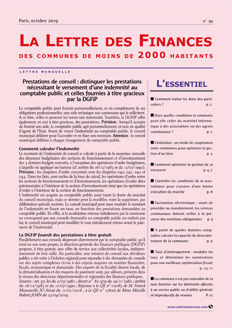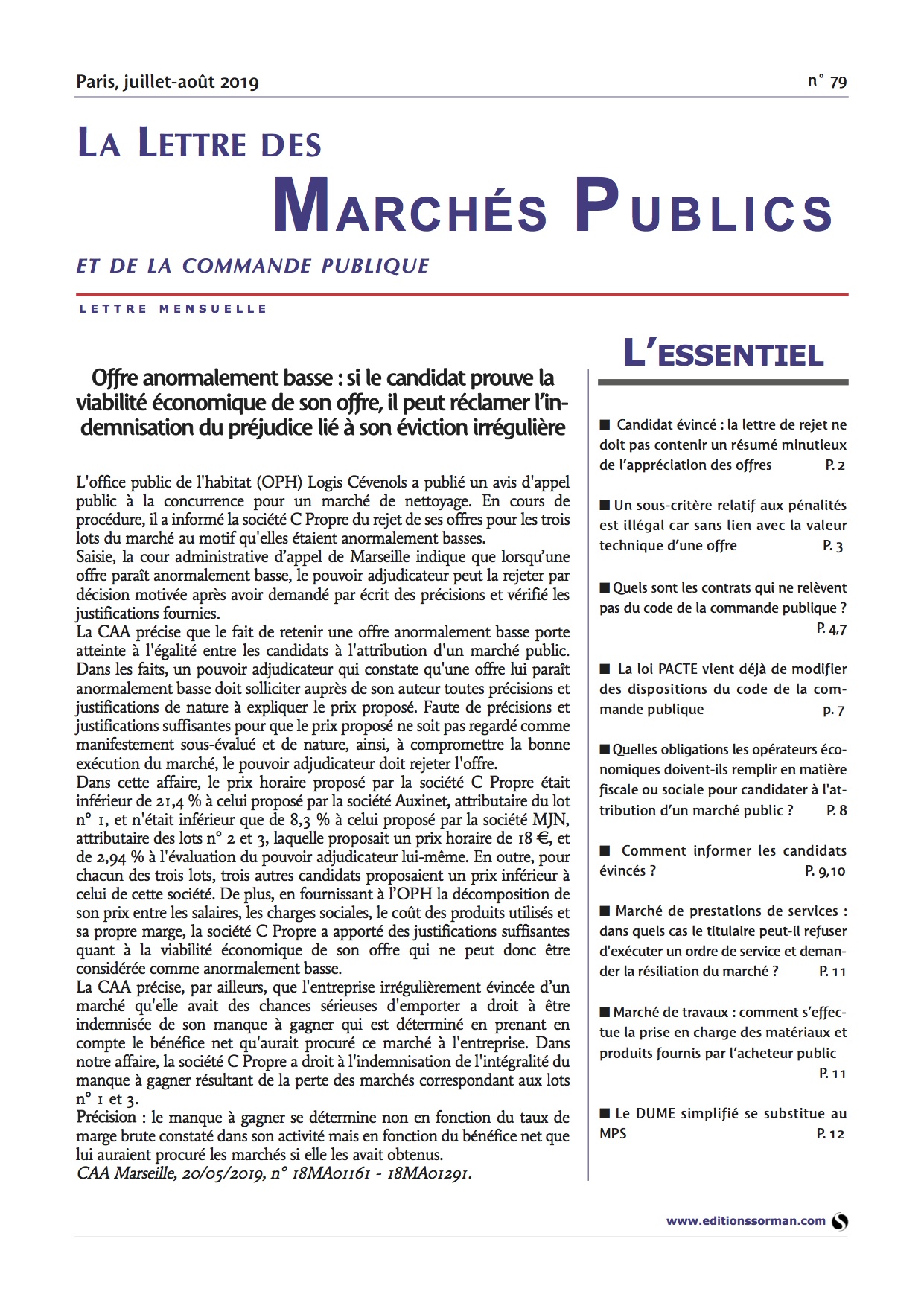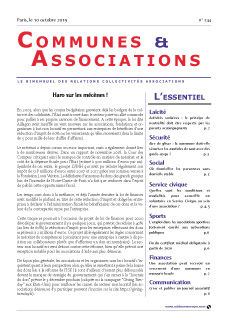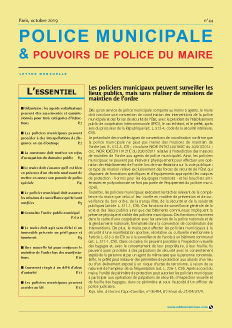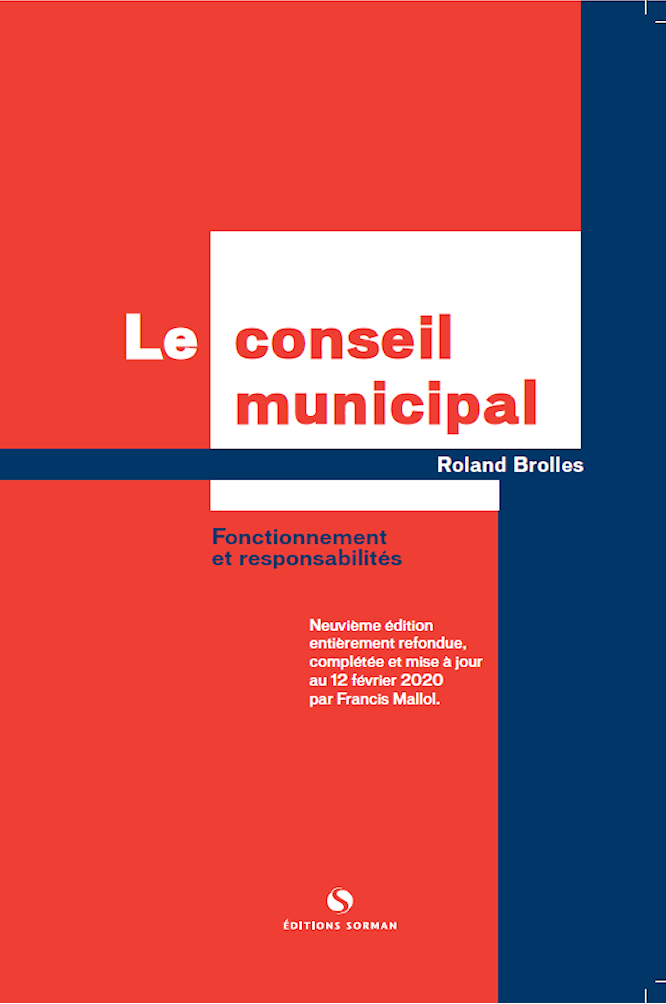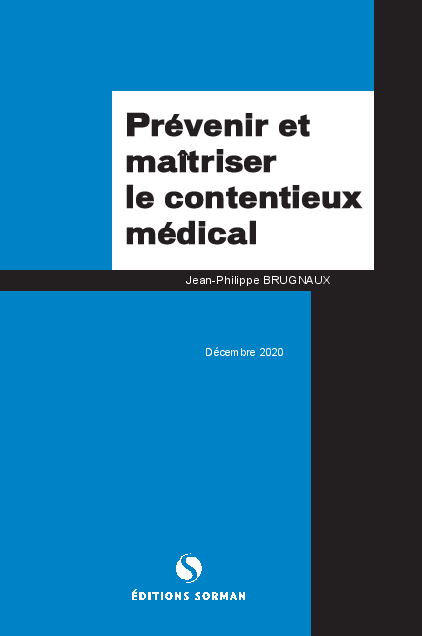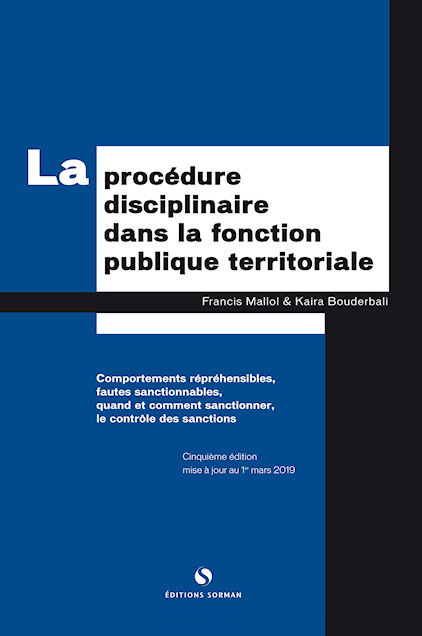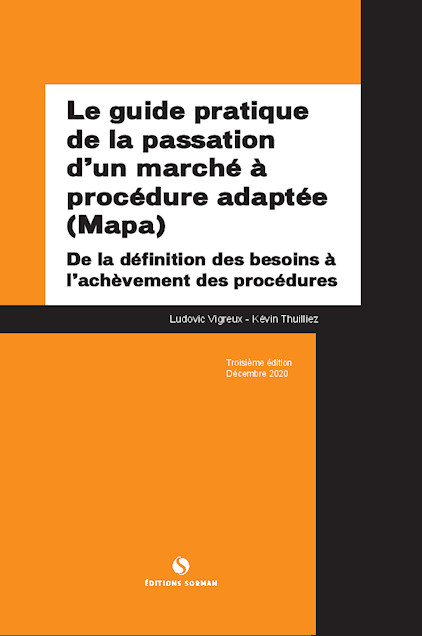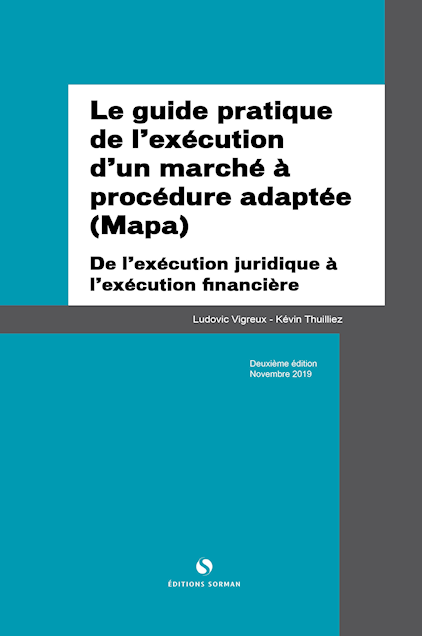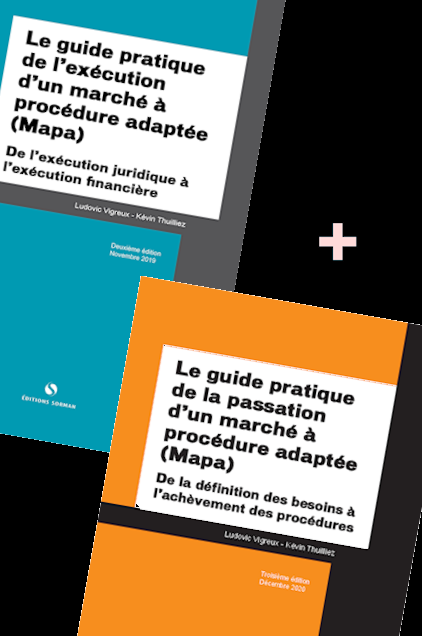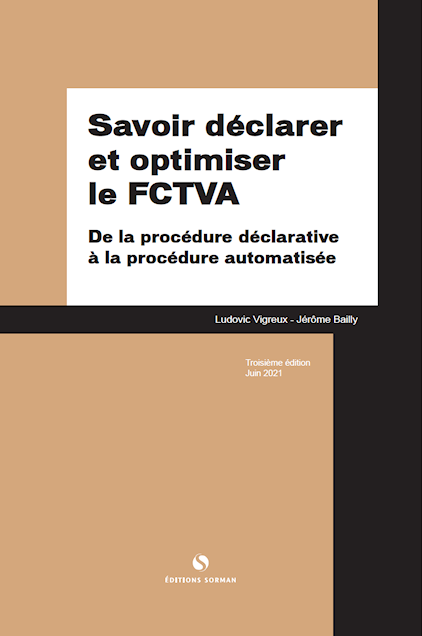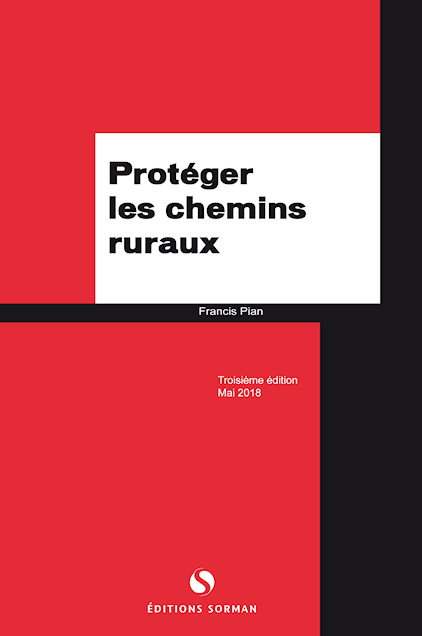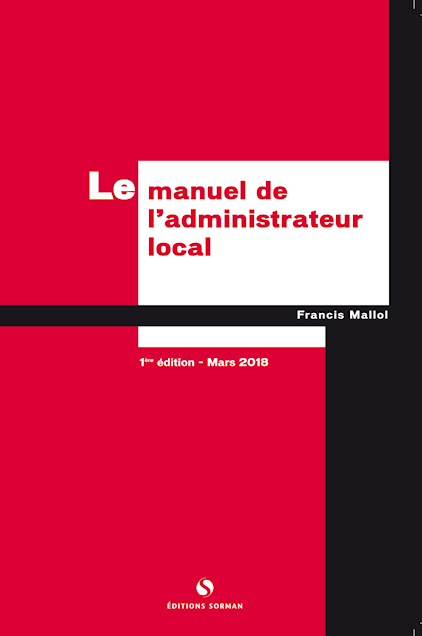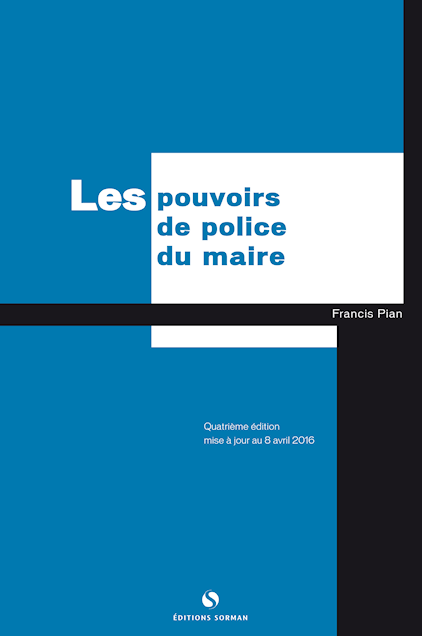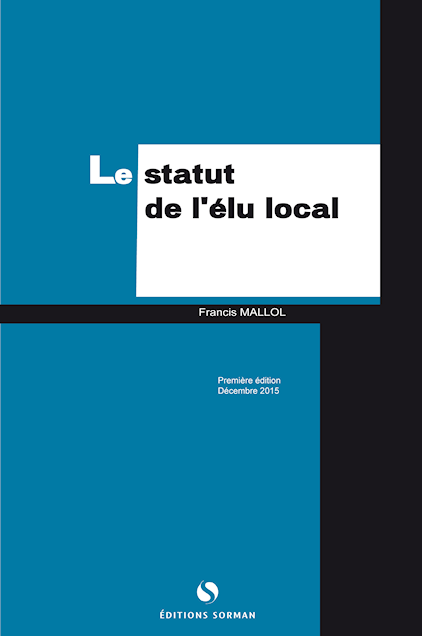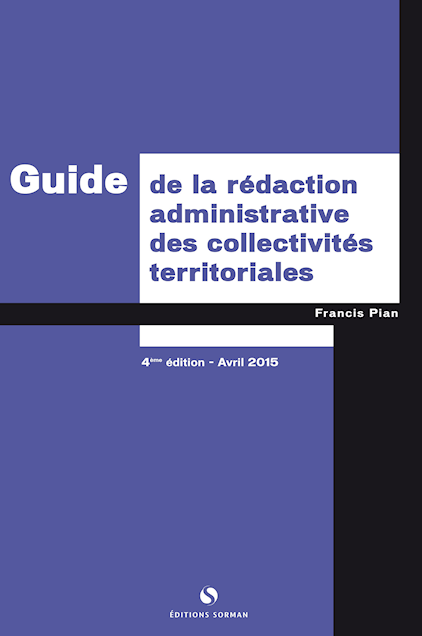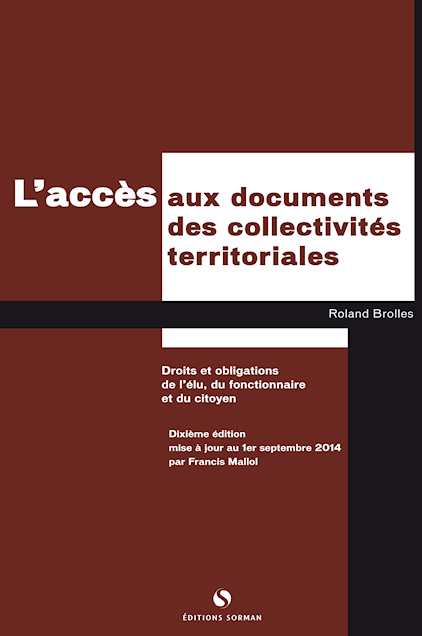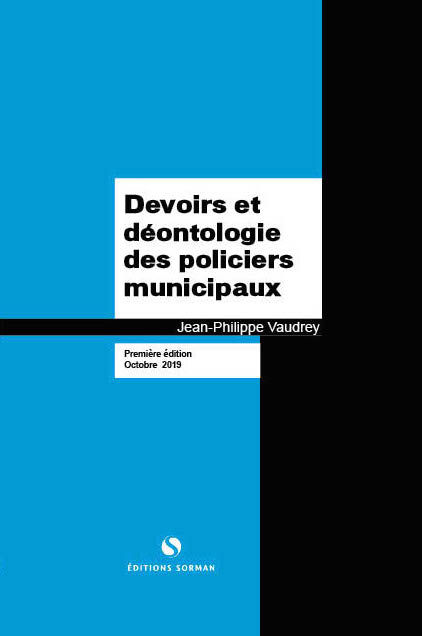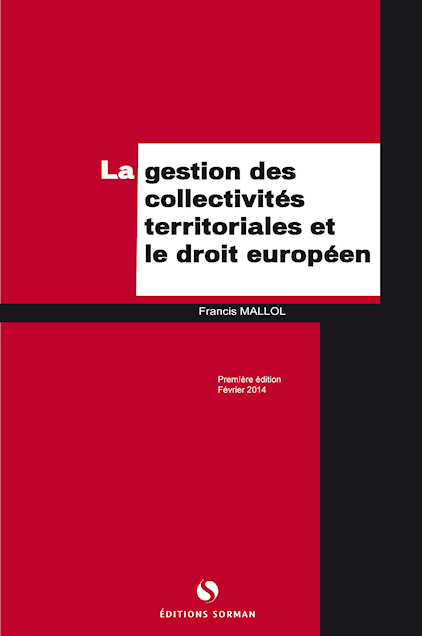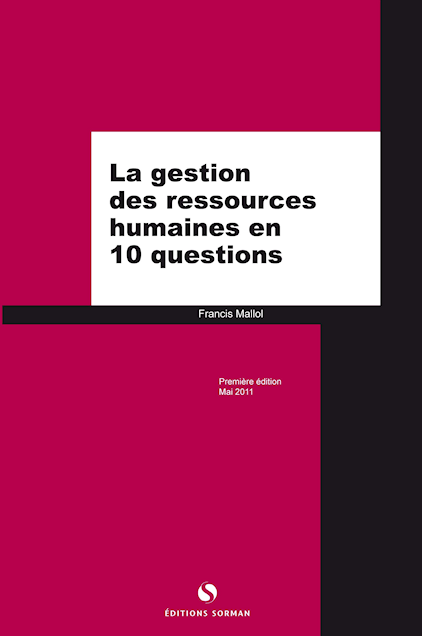Définition, protection et enjeux de la restauration Abonnés
Un monument historique est un immeuble (bâti ou non bâti : parc, jardin, grotte…) ou un objet mobilier (meuble ou immeuble par destination) recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger pour son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique afin qu’il soit conservé, restauré et mis en valeur.
Pour être « monument historique », l’immeuble ou l’objet mobilier doit être soit inscrit ou classé. Ce sont les deux niveaux de protection au titre des « Monuments historiques ». On compte aujourd’hui en France environ 45 080 immeubles protégés au titre des monuments historiques, dont 14 317 classés et 30 763 inscrits.
La demande de protection peut émaner du propriétaire du bien, de l’affectataire, ou de toute personne y ayant intérêt (collectivités territoriales, association de défense du patrimoine, etc…). L’initiative d’une protection peut aussi venir des services du préfet de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles) ou du ministère de la Culture (Direction Générale des Patrimoines et de l’Architecture). Cette protection constitue une servitude d’utilité publique (Servitude de type AC 1) affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
Les travaux sur monuments historiques
Les travaux d’entretien, de réparation et de restauration sur les monuments historiques sont régis par le livre VI du code du patrimoine. Ils sont effectués sous le contrôle scientifique et technique (CST) des agents des services patrimoniaux de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Le propriétaire d’un monument historique est le maître d’ouvrage des travaux qui y sont entrepris. Ces travaux peuvent bénéficier d’une participation financière de l’État déterminée en tenant compte de l’état sanitaire du bâti, de l’urgence des travaux, de l’ouverture du monument au public et des moyens budgétaires dont dispose l’État.
Avant d’entreprendre une campagne de travaux de restauration sur un monument historique, il est impératif de définir un programme. Celui-ci doit prendre en compte l’état général du bâtiment, les priorités en termes de conservation et de mise en valeur, les contraintes liées à l’utilisation de l’édifice (conformité aux normes en vigueur, sécurité du public, accessibilité) et les moyens que le propriétaire est susceptible d’y affecter avec l’aide éventuelle de l’État et des collectivités ou mécènes potentiels. De la bonne définition du programme dépendra le succès de l’opération.
La collectivité maître d’ouvrage est invitée à consulter la DRAC dès la phase de définition du programme afin de bénéficier pleinement du contrôle scientifique et technique dans son volet conseil et expertise. Au cours de cette phase de concertation, les services de la DRAC mettent à la disposition du maître d’ouvrage, toutes les informations utiles, notamment l’état des connaissances dont ils disposent sur le monument. Ils indiquent les contraintes et les servitudes patrimoniales, architecturales et techniques que le projet de travaux devra respecter et apportent expertise et conseils au maître d’ouvrage.
La collectivité maître d’ouvrage choisit le maître d’œuvre, sous le contrôle scientifique et technique de l’État, parmi les architectes titulaires du diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine » ou de tout autre diplôme européen reconnu de niveau équivalent, ou alors parmi les architectes en chef des monuments historiques territorialement compétents. Le choix des entreprises compétentes est particulièrement important en matière de restauration de monuments historiques. Mais il n’existe pas de procédure d’agrément ou d’habilitation délivrés par les services de l’État pour les entreprises intervenant sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques.
La demande d’autorisation de travaux sur un objet mobilier classé doit être constituée d’un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d’état, le diagnostic et les propositions d’intervention ainsi que des photographies permettant d’apprécier l’état de l’objet et le projet de travaux.
Carole Diart le 13 novembre 2025 - n°31 de La Lettre des Services Techniques
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline